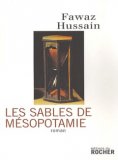******
« Chapitre six dans lequel il est question des différentes communautés qui constituent une agréable mosaïque à regarder surtout pour un enfant. »
Dans ma ville, les chrétiens possédaient des boutiques d’alimentation, des cordonneries, des bijouteries, des débits de tabac et de boisson et ils avaient en plus une bonne réputation, enviable par les autres commerçants. Nous, nous n’étions que des paysans analphabètes, nous ne possédions que notre ignorance. Puisque Dieu dans son Coran nous demandait d’œuvrer pour notre vie comme si nous étions éternels et pour l’au-delà comme si nous allions mourir le lendemain, nous avions beaucoup à apprendre d’eux pour ce qui concernait la vie d’ici-bas. Nous n’avions qu’à copier sur eux pour tout ce qui était de l’ordre de l’éphémère, mais, pour l’éternité, on avait une sacrée avance sur les autres croyances, on avait des garanties en béton.
Les Arméniens représentaient à nos yeux le gratin du gratin, la crème de la crème de notre société. Ils avaient l’avantage sur leurs coreligionnaires syriaques et assyriens de parler le kurde aussi bien que nous si ce n’était mieux et d’être liés à nous par des liens du sang, par le biais de la circoncision. Pour nous, les Arméniens étaient des Kurdes, mais pour des raisons qui nous échappaient, Dieu tout-puissant n’avait pas jugé utile de les convertir à la droite religion musulmane. Quant aux bav-fileh, c’est-à-dire les Arméniens qui s’étaient défaits de leur christianisme pendant les années noires du génocide sans doute pour échapper à une mort certaine, ils étaient des Kurdes à part entière, rien ne les distinguait de nous, à part peut-être leur sens des affaires. J’avais de la peine à imaginer ces braves gens mijoter pour l’éternité dans les flammes de l’enfer tout simplement parce qu’ils n’étaient pas musulmans comme nous. Les pauvres, ils n’avaient pas la moindre chance de se retrouver un jour dans le paradis d’Allah exclusivement réservé aux fidèles de notre doctrine, celle de Mahomet, le dernier prophète.
Si les Arméniennes de la génération de mes grands- parents s’habillaient comme les femmes kurdes, leurs jeunes filles transformaient d’une manière permanente le quartier chrétien d’Amoudé en véritables Champs- Élysées. Elles se déplaçaient en jupes courtes et en pantalons moulants et au lieu de rougir par pudeur, elles semblaient plutôt fières de la rondeur nerveuse de leur derrière et de la largeur nonchalante de leurs hanches. Elles se découvraient le chef et leurs bras nus étaient aussi blancs et aussi doux que le beurre qui flottait à la surface du lait longuement baratté dans une outre de peau de bouc. Elles se parfumaient derrière les oreilles et dans l’échancrure de la poitrine. Selon les dires de Nouri, un ami qui partagerait plus tard avec nous la passion des films indiens, on aurait pu préparer le meilleur thé avec la transpiration des aisselles de Léna, son institutrice arménienne.
Le soir, dans le quartier chrétien, les femmes arrosaient abondamment devant chez elles, elles chassaient à coups de seaux d’eau fraîche le reste de la chaleur emmagasinée dans le ciment du trottoir et le goudron de la chaussée. Elles installaient des chaises et des tabourets devant les portes et se réunissaient pour papoter entre elles et boire du café ou des boissons rafraîchissantes et manger des graines de pastèque ou de tournesol. Bras dessus bras dessous, les jeunes filles confiaient leur chevelure enduite d’extraits d’essence venus de Damas, de Beyrouth et probablement de Paris jusqu’à la brise vespérale de Mésopotamie. Elles représentaient la joie de vivre, la liberté, le bien-être dont nous nous sentions atrocement privés. Sous les lampadaires, leurs éclats de rire montaient comme des cascades de cristaux vers le firmament où cheminait paresseusement la lune et où scintillaient des milliards d’étoiles grosses et petites.
Chassés par la frustration et les innombrables interdictions, ceux des jeunes musulmans dont « l’eau avait déjà tourné dans les testicules »– une expression qui désignait les jeunes gens pubères –, affluaient vers ce jardin de volupté, cette oasis de couleurs et de senteurs. Tenaillés par le désir le plus intense, ils prenaient d’assaut en particulier une rue qu’on avait baptisée « la Rue de l’amour », celle qui séparait l’église catholique de sa sœur syriaque. Là-bas, on pouvait longuement se rincer l’œil et admirer les jeunes corps dont le sang battait rageusement sous les chemisettes colorées. On pouvait regarder, imaginer le parfum de ces roses de sensualité, mais on n’avait pas le droit de les cueillir ou de respirer de près leurs essences envoûtantes. Malgré les promesses d’un paradis musulman où languissaient des houris dont la virginité demeurait intacte, nombreux étaient ceux qui pour un baiser volé ou une étreinte prolongée étaient prêts à se convertir à la religion de l’amour qui était celle de Jésus.
Les Arméniens et les chrétiens en général différaient de nous également dans la mesure où ils abhorraient les rixes, les conflits, les soucis dont personne n’avait réellement besoin. Nous les Kurdes, on pouvait déclencher une troisième guerre mondiale pour une poule écrasée par une bicyclette ou deux gamins qui s’étaient battus pour une poignée de billes. Les hommes devenaient des dromadaires enragés, ils écumaient de colère et brandissaient les poignards, les coutelas, les pioches, les pelles, les gourdins, enfin tout ce qui pouvait mettre la vie en danger. Il fallait une intervention de la police, des dignitaires religieux ou des seigneurs féodaux pour mettre fin à ces conflits et restaurer la paix. Quant aux Arméniens, si quelqu’un cherchait noise à l’un d’eux et leur criait par en exemple « nique ta sale putain de mère », il ne se fâchait pas, enfin il faisait semblant de rester calme. Il répondait : « À ma connaissance, ma mère n’est ni sale ni putain. Mais si tu veux la niquer et si elle est consentante, vas-y, moi, je n’ai rien contre. » Ce genre de réponse bouclait la bouche de l’enragé. En général, l’entourage riait et l’Arménien passait son chemin. Dans ces moments-là, on les trouvait parfois lâches. Il fallait se défendre, casser la gueule de celui qui tenait des propos si injurieux. Malgré tout cela, on avait du respect pour ces hommes si honnêtes, si corrects dans leur travail et dans leurs relations avec les autres. On jalousait la qualité de vie qu’ils menaient.
Si les chrétiens représentaient des exemples à suivre pour intégrer la modernité et entrer corps et âme dans l’ère de la civilisation, nous savions qu’il y avait encore pire que nous. Bien que Kurdes comme nous, les yézidis incarnaient à nos yeux la vie la plus primitive et l’obscurantisme le plus total. Ils symbolisaient la branche malade dont souffrait notre arbre généalogique. Ils étaient les parents pauvres dont on avait honte. D’abord, on ne savait pas grand-chose sur leur religion, qui dans le passé avait attiré sur eux les foudres de l’Empire ottoman, se voulant le garant de la voie orthodoxe de l’islam. Quand on leur posait des questions sur leurs pratiques religieuses, ils s’esquivaient, formulaient des réponses évasives. Mais lorsque l’étau se serrait autour de leur cou, et qu’ils ne pouvaient plus s’esquiver comme un lapin pourchassé par une horde de chiens, ils avouaient leur ignorance. Ils devaient rester dans l’ignorance presque totale de tout ce qui concernait les fondements de leur foi. La connaissance approfondie était l’apanage d’une petite élite de « princes »et de pîr, qui se faisaient rares dans la contrée et qui descendaient de temps à autre des hauts plateaux du Kurdistan irakien pour effectuer des tournées. Les simples fidèles s’abstenaient de se poser des questions métaphysiques. Ils devaient se contenter de quelques bribes de versets formulées dans un drôle de mélange de mots kurdes et arabes, quelques petites prières prononcées au lever du soleil et d’autres au coucher. Ils avaient les mêmes noms et prénoms que nous, mais ils se foutaient complètement des cinq prières obligatoires qui constituent l’un des cinq piliers de l’islam. Ils ne savaient pas ce qu’était le mois de ramadan, le carême. Ils prétendaient même que Mohamed avait carrément des problèmes d’audition, qu’il était malentendant. Le jour où il est monté au ciel sur le dos du Boraq, la jument ailée, pour rencontrer le Créateur et discuter avec lui de l’allégement des devoirs incombant aux fidèles de sa nouvelle religion, Dieu lui a dit « sê roj », ce qui veut dire en kurde, « trois jours ». Mais le nouvel élu a entendu « Sî roj », c’est-à-dire, trente jours de jeûne. À cause de cela, les musulmans font le ramadan pendant un mois et eux uniquement trois jours.
Les yézidis étaient bien bizarres. En leur présence, il fallait s’abstenir de prononcer des qualificatifs péjoratifs à l’encontre de Satan tels que « le maudit »ou « va au diable ». On ne savait pas quelle mouche les piquait lorsqu’on utilisait des expressions comme « se faire l’avocat du diable », « faire le diable à quatre », « se démener comme un beau diable », « tirer le diable par la queue », « s’agiter comme un diable ». Puis, à table, on devait être prudent avec les mets qu’on mettait devant eux. Ainsi, il ne fallait jamais leur servir de la laitue car selon leurs superstitions l’archange déchu s’y était caché pour fuir la colère du Créateur.
Dans la ville, on les reconnaissait à leurs vêtements tout blancs, à leurs grosses moustaches et à l’air maladroit et craintif qui ne les quittait jamais. Les hommes âgés étaient encore plus reconnaissables à leur immense barbe blanche, qui arrivait souvent jusqu’à l’échancrure de leur robe en coton blanc. Ils venaient vendre la laine de leurs moutons et les produits laitiers pour acheter du thé, du sucre, du savon et ce dont ils pouvaient avoir besoin. Ils aimaient bien la compagnie des chrétiens, plus tolérants et plus commerçants que les musulmans, en tout cas plus respectueux des us et des coutumes de ces drôles de zigotos de yézidis, adorateurs du diable.
Le mariage entre les Kurdes de confession musulmane et les yézidis était strictement interdit. Mais il restait la circoncision rituelle, qui nous permettait de nous rapprocher des autres communautés et de sceller avec elles des alliances bénéfiques, voire salutaires surtout dans les temps troublés. L’ablation rituelle du prépuce d’un jeune Kurde musulman créait entre lui et son parrain un lien de sang. Le « circoncis » et son kriv devenaient des membres de la même famille. Les quelques gouttes de sang versées par la lame du mollah scellaient à jamais un lien d’affection et de parenté entre l’adulte et l’enfant. Aussi, on cherchait des alliances avantageuses, on choisissait des hommes influents et aisés pour parer aux coups du destin.
On racontait des anecdotes croustillantes à propos de ces drôles de Kurdes. On dit qu’un jour, un yézidi arriva de son village chez un ami musulman habitant le chef-lieu du district. Le Kurde musulman étant obligé de se rendre à son travail, il demanda à sa femme de s’occuper de son kriv jusqu’à son retour le soir. Or, la femme passa la journée à vaquer à ses occupations. Elle passait de temps en temps par la pièce ou le yézidi était assis. À chaque fois, elle l’observait, le dévisageait comme s’il s’agissait d’un extraterrestre. Elle promenait son regard sur les poils qui lui couvraient le visage et qui se confondaient avec la longue chemise blanche qu’il portait. Entouré de coussins ornés de broderies et de dentelles représentant des motifs végétaux, le yézidi écumait de rage dans son for intérieur car il avait faim et soif et qu’il ne comprenait pas l’attitude de sa kriv.
Tard dans la soirée, le mari rentra à la maison. Il demanda à son épouse ce qu’elle avait offert à manger à leur kriv. « Rien, répondit la femme.
– Comment rien ? tu es devenue folle ou quoi ? Dans notre région, le thé, on le sert presque toutes les heures, toujours brûlant dans de petits verres très transparents pour qu’on voie bien la couleur du liquide, une traînée de rubis, de braises incandescentes. Dans les foyers kurdes, le thé est la boisson nationale, le whisky local qu’on boit sans modération. Dans la journée, on le sert au moins une demi-douzaine de fois. » La femme fixa de nouveau le visage enfoui sous l’impressionnante masse de poils.
– « Mais est-ce qu’il a une bouche pour manger ou pour boire », dit-elle ?
À cette phrase, le yézidi laissa exploser la colère contenue en lui depuis le matin. Il souleva de ses deux mains ses lourdes moustaches et pointa de ses deux index la cavité noire au milieu du visage.
– « Mais c’est quoi ça si ce n’est pas une bouche, mégère ? Est-ce ta chatte ? »
Au village, on voyait en été les Arabes bédouins passer avec leurs troupeaux de moutons, leurs dromadaires et leurs ânes. Ils venaient les faire paître dans les champs de blé après le passage des moissonneuses-batteuses. Nous ne leur souhaitions aucun mal car ils étaient musulmans comme nous, et ils avaient l’avantage de s’exprimer directement dans la langue du Coran. Mahomet, le bien-aimé d’Allah, son messager et le sceau des prophètes, était l’un des leurs. Il était arabe même si plusieurs savants sur la doctrine islamique chez nous s’ingéniaient à faire de lui un Kurde de pure souche. Ces voix, pour le moins farfelues, prétendaient que Dieu tout-puissant avait décidé d’envoyer le Coran en arabe parce que c’était l’unique moyen pour lui de se faire entendre de ces populations bédouines réputées pour l’étroitesse de leur esprit et leur obscurantisme total. Mollah Ahmadé Harbi, notre maître de l’école coranique, faisait fi de ces élucubrations trop sophistiquées pour nos cerveaux de moineaux. Pour lui, Mahomet appartenait à l’humanité tout entière ! Il était le dernier élu destiné par Dieu tout-puissant à boucler la boucle et à mettre fin aux hérésies et aux fausses prophéties qui pullulaient dans le monde comme les champignons dans la forêt après la pluie. Assis au milieu de notre assemblée, son long bâton de bambou dans une main, il caressait de l’autre sa barbe déjà poivre et sel. Il nous expliquait, en kurde bien sûr, que Dieu nous avait créés et répartis en ethnies et en tribus différentes pour que nous sachions que les meilleurs parmi nous étaient les plus pieux, les plus droits. Le degré de dévotion était l’unique chose qui pourrait constituer une différence entre un Persan et un Arabe. Notre rôle à nous consistait à lire le maximum de pages du Coran, à bien articuler les versets et à apprendre les sourates courtes par cœur pour les insérer dans les cinq prières quotidiennes. Quand l’un de nous lisait le Livre saint dans son intégralité, notre maître se voyait l’homme le plus heureux de la contrée, voire du monde. Il mesurait, en caressant sa barbe, les lopins de terre que Dieu lui attribuerait dans le paradis céleste et le nombre de nouvelles houris, ces belles éternellement vierges, qu’il ajouterait à son harem.
Donc, nous n’avions rien contre eux, nous ne détestions personne. Ce furent surtout les agents des services secrets et les membres du Parti unique qui distillèrent la haine et semèrent la zizanie dans nos rangs. Jour après jour, les représentants du nouvel État renforcèrent en nous le sentiment d’appartenir à des ethnies et à des religions différentes. Ils apprirent à nos parents la didactique de la peur et les vocables de la haine. Avant l’arrivée de la politique chez nous, on savait les bédouins différents car ils venaient de loin et ne parlaient pas notre langue. Et puis, ils avaient la réputation d’être sales, de promener partout leurs colonies de poux et de puces. Ils s’attaquaient la nuit au bétail des pauvres paysans car, selon leurs coutumes, le vol des brebis ou des veaux ne constituait ni un péché devant Dieu ni un délit passible de peine de prison. Pour eux, c’était un sport national, un exercice de courage et d’adresse. Puis, ils se servaient royalement dans les vignes et dans les vergers où poussaient les pastèques et les melons. Avant les premiers froids de l’automne, ils disparaissaient avec leurs tentes et leurs animaux. Ils repartaient d’où ils étaient venus et personne ne regrettait leur départ.
Extrait des « Sables de Mésopotamie ». Fawaz Hussain. Editions du Rocher, 2007. 312 pages. ISBN 2268061442, 9782268061443
À propos de l’auteur
Fawaz Hussain est né au nord-est de la Syrie dans une famille kurde. Il arrive à Paris en 1978 afin de poursuivre des études supérieures de lettres modernes à la Sorbonne. Il vit à Paris dans le XXè arrondissement où il se consacre à l’écriture et à la traduction des classiques français en kurde, sa langue maternelle.
Du même auteur
* Le Fleuve, Méréal, 1997, réédité par éd. du Rocher/Le Serpent à Plumes/ Motifs, 2006.
* Prof dans une ZEP ordinaire, éd. du Rocher /Le Serpent à Plumes, 2006.
* Les Sables de Mésopotamie, éd. du Rocher, 2007.
* En direction du vent, éditions Non Lieu, 2010.
* La Prophétie d’Abouna. Editions Ginkgo, 2013.