Captif du désir de la Ville
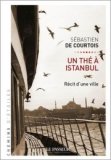
- Un Thé à Istanbul, récit d’une ville
- Sébastien de Courtois, Collection « Le Passeur »
- Crédits : Chemins d’étoiles
C’est que Sébastien de Courtois, journaliste de son état, qui « vit et travaille » à Istanbul, est exactement l’anti-Malraux, l’homme qui se faisait fort de comprendre un pays en trois heures. Un Thé à Istanbul multiplie au contraire les tentatives de familiarisation, diversifie les « entrées » moins dans que vers la ville (le sens premier de Constantinople, sens primordial pour cet amateur d’étymologie) : Istanbul vue des îles, vue de la rive orientale, vue d’avion, de nuit, vue de la Belle Époque, vue de la Conquête, vue des gravures occidentales, de la photographie locale, du cinéma allemand, du musicien d’Alep replié à Galata… Le promeneur est captif du désir de la Ville, désir de citoyenneté spirituelle, désir passionnel. C’est même plutôt, pour emprunter aux scénarios de la rencontre Orient-Occident, un avatar sympathique du croisé amoureux : si Sébastien fait ses Pâques, se dirige dans la Byzance impériale avec la même aisance que dans l’Istanbul contemporaine, ce fervent chrétien est épris d’une infidèle : il file dans les lieux sacrés tout un excitant (et désolé) romanzetto avec sa belle Esma : rendez-vous dans une église hors-les-murs, exploration à deux de recoins secrets d’ Aghia Sophia, tentative d’enfermement dans une église nouvellement répertoriée…
Cette intrigue en réalité n’est qu’à peine esquissée, c’est un mince thème qui court au travers de 10 chapitres, articulés selon une progression de plus en plus libre et attachante : les îles aux Princes du Bosphore, accueillantes à qui prend le temps d’une installation, même précaire ; le thé, rituel convivial ; la rive orientale et ses égarements contrôlés ; Henry, le fantôme d’un aimable aïeul qui abusait des adjectifs vides et entrevit le Pera de la Belle Époque ; Sainte-Sophie, cœur battant du livre et du narrateur ; l’hiver, ses replis mystiques, l’expatriation qui se cogne au sentiment de l’exil, à son âpreté, son aridité ; les deux figures tutélaires (forcément rivales) de la temizlikçi kadın, moins femme de ménage que divinité du foyer, et du kapıcı, moins concierge que divinité du seuil, personnages d’une vérité romanesque qui atteint au type ; Istanbouliotes natifs ou d’adoption, secrets ou diserts ; le no man’s land des murailles de Théodose ; le printemps de Taksim enfin, en guise de la plus incertaine des coda.
La suite de ces chapitres mobilise l’expérience unique de la ville où gravir et descendre les échelles du temps, métropole déconcertante entre toutes, destructrice, inhospitalière à ses plus anciens habitants, boulimique, tentaculaire, avec sa saison morte, ses disgrâces, son atmosphère irrespirable, ses zones d’ombre, sans exclure tout de même les classiques illustres de son architecture, grands ou petits (que les Stambouliotes ont tendance à dédaigner), ou les adresses à la mode. Des moments de grâce fugitive esquissent un cheminement plus recueilli : telle la visite proposée par un garçon de café d’une chapelle souterraine aux ex-voto marins devant lesquels le patron musulman allumerait une bougie, ou l’admission au deuil d’une famille alévi, détour imprévisible d’un apaisement intérieur, coïncidence du meilleur de soi avec le lieu et le moment.
Désemparé dans une ville-énigme
Bien des informations sont des emprunts assumés (aussi bien se lasserait-on de relire l’histoire de Sainte-Sophie ou celle de la prise de Constantinople ?). Mais ce « récit » est attachant par ses relevés d’ambiances urbaines, gratifiantes ou sinistres (la destruction du quartier gitan de Sulukule), ses notations sur le vif de rencontres avec lieux et gens, connus ou non (la figure mythique du père Jacob, mais aussi celle de la religieuse à poigne qui semble veiller sur lui). Et le narrateur séduit par ses impatiences, le fracas des illusions (individuelles et collectives), son infortune d’amoureux inconsolable d’une Esma (anagramme de sema, signe) qu’étrangement les signes indiffèrent — il est vrai que ceux-ci vous laissent souvent désemparé dans une ville-énigme qui prend un malin plaisir à les convoquer ou à les révoquer. Quand elle ne contraint pas comme aujourd’hui les meilleurs des siens à souscrire au « testament argentin » selon Cortázar, celui « de quelqu’un qui ne se sentait pas et ne se sentirait jamais un transfuge, mais qui avait le droit de vendre jusqu’au dernier livre et au dernier disque pour s’éloigner sans rancune, poliment, dans le port des adieux de la famille et des amis qui n’avaient jamais lu, ni liraient ce testament » (Crépuscule d’automne).
Ce qu’avec pudeur Sébastien de Courtois intitule « récit d’une ville » est bien plus : sa sensibilité mémorielle s’allie à un besoin de comprendre et d’aimer, une acuité spirituelle, qui n’étonnent guère de la part d’un lecteur de « l’homme aux semelles de vent » doublé d’un historien des religions : autour de cette recherche d’absolu, de ce point aveugle, gravitent ces dix chapitres. Cet itinéraire existentiel dessillerait les yeux des colporteurs de caricatures comme des amateurs de chromos devenus fonds de commerce d’auteurs et d’éditeurs avisés. Un livre à emporter avec soi comme un (léger) viatique, ou à mettre sur le même rayon que L’Amour des Voyageurs de Paul de Sinety.
(2014). Un Thé à Istanbul, récit d’une ville, collection « Le Passeur », Chemins d’étoiles, 208 p., ISBN: 978-2368900543 (http://www.le-passeur-editeur.com/les-livres/litt%C3%A9rature/un-th%C3%A9-%C (...)), RIS, BibTeX.

