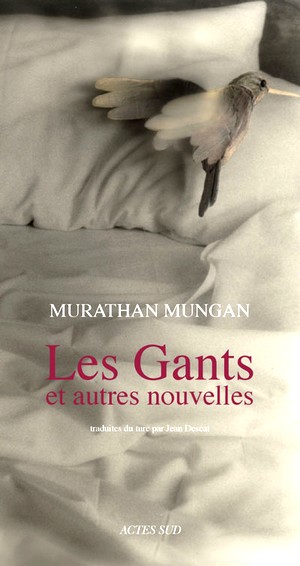![]() Murathan Mungan, Les Gants et autres nouvelles ; traduites du turc par Jean Descat (Actes Sud, 2011) 173 pages
Murathan Mungan, Les Gants et autres nouvelles ; traduites du turc par Jean Descat (Actes Sud, 2011) 173 pages
De ce recueil intensément spéculatif toutes les nouvelles tendent vers la dernière où elles se reflètent et qui en constitue une clef – aussi m’abstiendrai-je de commenter ce miroir où viennent s’échouer et rebondir toutes les histoires qui s’accumulent au fil des pages, dans des textes plus ou moins courts ou longs, écrits ces dix dernières années avec une sorte de méticulosité singulière. Reflet et basculement, comme si l’on passait de l’autre côté du réalisme et du souci de la vertu. Curieux recueil donc qui semble tourner le dos à toute étude romanesque de la passion.
L’amour y naît avec prudence, presque à reculons, comme si la distance que les personnages prennent par rapport à leur propre vie, mimée par la discrétion littéraire inscrite dans un style détaché, rationnel, relevait à la fois d’une morale et d’une esthétique. Ce n’est pas que l’on redoute les effets dévastateurs d’une passion, qui brille par son absence totale dans ce livre consacré à l’amour, anti proustien dans ce sens alors qu’il est proustien en diable pour son travail sur la mémoire et sa conception de l’écriture, qui constitue le fruit fécondé d’un amour qui a vécu. C’est plutôt un rapport singulier au bonheur dont les nouvelles tentent de cerner sinon une définition du moins une incarnation : est-il sentiment, est-il la réalité du quotidien qui se révèle tranquille, épanouissant, osons le mot, parfait, ou est-il cette fécondité promise et obtenue de l’écriture pour le désigner rétrospectivement, ce bonheur dont on s’est bien gardé de le clamer quand on le vivait, et même de le vivre pleinement pour éviter de le perdre, sauf dans les rares moments de trouée dans cette économie du silence où sa force a submergé l’habitude acquise de se taire. Dans ce cas, la retenue par rapport à sa propre vie est une superstition, dans un livre qui est pénétré d’une forme indicible de spiritualité que j’identifie dans cette crainte, qui donne une écriture apotropaïque même quand elle décrit des événements après coup, comme si dire, se féliciter, faire savoir, risquaient de faire enfuir la beauté de ce que chacun vit – de ce que les auteurs écrivent, car bien des nouvelles mettent en scène des personnages qui à un moment se mettent à écrire, à la fois en pleine conscience de ce qu’ils substituent autre chose à l’amour, autre chose qui le prolonge voire lui donne l’intensité d’existence après que l’expérience réelle s’en est enfuie sur le mode feutré, presque incrédule.
Écriture, discrétion et retenue
Prudence, discrétion, superstition, crainte, écriture, lieu paradoxal où vient se réfugier la parole que les personnages manifestement ont jugé préférable de bannir de celles de leurs relations auxquelles ils tiennent. La parole juge, entremet, sépare, lieu de toutes les calamités et mécompréhensions, elle devient possible dans l’écriture, à condition que celui qui tient la plume le fasse avec quelques pincettes, dans la conscience qu’il manie de la fragilité.
Prudence et superstition du fils qui ne dit pas à son père que, comme lui l’a fait, il va à son tour partir, de peur que sa fuite n’échoue, de peur d’avouer à son père qu’il lui pardonne et qu’il lui ressemble, ce père qui, en son temps, était parti abandonnant son fils qu’il n’a revu qu’à l’adolescence, une fois fixé lui-même.
Discrétion et écriture pour la femme de la première nouvelle dont le mariage tardif, presque arrangé, avec un homme parfait, est comme un rêve fragile : amants passionnés, parents responsables, adultes égaux, heureux en toutes choses, ils sont deux rocs qui ne se parlent guère, sauf à l’heure où sa mère qui l’avait abandonné enfant et qui, revenue en Turquie, ne le voyait pas davantage, meurt : alors elle contemple ce gouffre d’émotion et de larmes qu’il peut être, observant en elle, alors qu’elle lui donne son amour à l’instant de la détresse, la puissance de cet amour qu’elle épargne dès lors et consigne, comme une miette précieuse, dans l’écriture.
Discrétion et affichage dans l’histoire étonnante de ce jeune homme, ancien obèse, qui après avoir mené une lutte pied à pied contre son corps et ses bouffissures, fait la conquête d’un écrivain homosexuel avec qui il entretient une relation ambivalente, l’aguichant sans jamais se donner. Puis l’écrivain meurt, et si l’ex obèse devenu beau comme un dieu, vivant dans une certaine extériorité par rapport à son apparence, ne sait toujours pas donner de nom à cette relation incommensurable, il sait que son corps dont il se servait comme d’un masque ne sera plus ce facile appât.
La superstition est ici réhabilitée comme une vertu qui produit ses effets en se jouant du temps : distorsion et propitiation, comme dans l’étonnante nouvelle « Collision » où la narratrice apprenant que son mari la trompe se précipite vers l’aéroport pour hâter la confrontation avec lui ; mais un simple accident du taxi – un chien peut-être écrasé, fatalité pour une personne qui a voué sa vie à la protection des animaux – bascule au passé sa précipitation : « les souffrances qui m’attendaient après le divorce commençaient déjà à s’atténuer » ; admirable regard sur une femme soudain étrangère, soudain criminelle, elle-même, qu’elle « voyai[t] depuis tant d’années dans les miroirs et qu[’elle] croyai[t] bien connaître ».
Résistance féminine
Une superstition qui rôde, sans autel et sans dieu ou un dieu faible, sans prière, avec un soupçon de croyances ésotériques peut-être (le surgissement déconcertant de l’astrologie dans la première nouvelle) mais qui résonne tout particulièrement dans cette société stambouliote dont les nouvelles révèlent le conflit entre les traditions d’un côté et leurs formidables bouleversements de l’autre – homosexualité affichée, liberté de la femme, pour ne mentionner que les manifestations les plus évidentes de la modernité pour un occidental dont l’esprit est peut-être encore habité de quelques préjugés, mais on peut souligner également la riche palette d’activités professionnelles et sociales des différents personnages. L’auteur sait pointer avec une profondeur psychologique aiguë que ce sont les femmes qui, au-delà de leur apparence émancipée, sont peut-être celles qui résistent le plus au changement, à l’effondrement du monde passé, sans doute parce que leur féminité, donnée auparavant comme un fait naturel, est mise à mal : ainsi de cette nouvelle où une journaliste, féministe comme il se doit, cultivée, en même temps que certaine de son bon naturel, se trouve totalement déstabilisée dans ce qu’elle croit être, dans ce qu’elle a toujours voulu être – un parangon de tolérance et d’ouverture – parce que soudain la retranscription d’une cassette d’un écrivain ami, qu’elle vient d’interviewer, lui révèle, par les intonations de la voix, qu’elle perçoit d’autant mieux qu’elle est contrainte à ce travail très matériel, ce qu’elle savait depuis toujours, sans le vivre au cœur de sa sensibilité et de son émotivité : la voix de l’homme est grosse d’un désir, elle n’est point si lisse comme on le croyait, il est homosexuel. Le dégoût. La honte.
« Là où les réalités s’absentent et deviennent des vérités... »
Car les nouvelles paraissent si policées, renvoyant à un monde parfait de vertu et d’harmonie, où les gens sont bons et où les événements ont une certaine rationalité dès lors que l’être humain les accueille et les anticipe avec prudence et modération, et pourtant le tout autre surgit, dans un tourbillon de paradoxe qui n’est pas virtuosité littéraire : ce peut être une collection de gants, ou soudain le silence, ou bien ce dégoût, ou un miroir qui renvoie une image inconnue…
La prudence de ne pas nommer, et de nommer seulement quand les réalités s’absentent et deviennent des vérités : une relation commencée dans la prostitution et la pornographie se défait pour ce qui est de l’étreinte des corps et se dit comme amour quand la femme disparaît, dont on a vu la mère croupir dans son urine. Misère des corps, fragilité : la mesure gestuelle et verbale des personnages qui ont la maîtrise d’eux-mêmes les transforme en funambules, juste un peu dans la vie, juste un peu en dehors, portant des secrets qu’ils brûlent de sonder et qui plongent dans les fractures de l’enfance, de la ville à la campagne, de la nature au monde de la culture, de l’ici et de l’ailleurs dans un perpétuel exil. Le révélateur, c’est l’image et non la parole, car les personnages protègent le bonheur derrière des mots sibyllins, conscients de ce qu’il est une illusion, mais que cette illusion n’est rien d’autre que la vie, et qu’elle sera vérité dès lors qu’on saura l’écrire. Et c’est ainsi que les nouvelles, insensiblement, mais constamment, obstinément, passent de la morale et de la vertu à des miroitements fantastiques. Il faut tout lire, dans une merveilleuse traduction (à quelques accrocs près), pour arriver à cette orchestration troublante qu’est la dernière nouvelle. Et toutes celles dont je n’ai rien dit. Le plus étonnant ? Que ces nouvelles soient mystiques. La joie est leur seul sujet, leur seul effet, leur seul objet.
![]() Murathan Mungan, Les Gants et autres nouvelles ; traduites du turc par Jean Descat (Actes Sud, 2011) 173 pages
Murathan Mungan, Les Gants et autres nouvelles ; traduites du turc par Jean Descat (Actes Sud, 2011) 173 pages