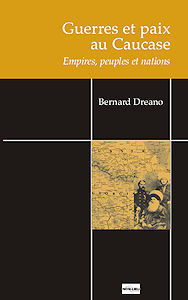 La Turquie est déjà un acteur majeur dans le Sud-Caucase. C’est manifeste sur le plan économique en Azerbaïdjan, en Géorgie, où la Turquie est le premier investisseur, et les échanges avec l’Arménie sont importants malgré la fermeture (jusqu’à quand ?) de la frontière, sans parler des nouveaux travailleurs immigrés arméniens en Turquie, qui sont déjà plus nombreux (peut-être 60 000) que la communauté arménienne turque (50 000).
La Turquie est déjà un acteur majeur dans le Sud-Caucase. C’est manifeste sur le plan économique en Azerbaïdjan, en Géorgie, où la Turquie est le premier investisseur, et les échanges avec l’Arménie sont importants malgré la fermeture (jusqu’à quand ?) de la frontière, sans parler des nouveaux travailleurs immigrés arméniens en Turquie, qui sont déjà plus nombreux (peut-être 60 000) que la communauté arménienne turque (50 000).
La Turquie constitue aujourd’hui un pôle économique et culturel très significatif pour toute la région, et dispose de capacités de médiatrice potentielle dans les conflits en cours. Bien sûr l’opinion publique turque est favorable aux « frères azerbaïdjanais » et les courants les plus nationalistes sont ouvertement hostiles à l’« ennemi arménien », bien sûr la diaspora abkhaze, présente en Turquie, est solidaire de l’Abkhazie. Mais le président Gül et le Premier ministre Erdogan et le gouvernement « islamo-démocrate » restent prudents, fidèles à leur ligne d’équilibre. Ils n’ont pas suivi Bush et Saakachvili dans une confrontation avec les Russes. Les Turcs, comme les Français et les Allemands, se sont opposés à une intégration rapide et provocatrice de la Géorgie à l’OTAN, mais pas question non plus de contribuer à la déstabilisation de la région et de laisser tomber la Géorgie, de reconnaître l’indépendance de l’Ossétie et de l’Abkhazie.
La Turquie n’est pas restée immobile en cette année 2008. Les discrètes négociations du printemps avec les Arméniens ont abouti à la présence historique du président turc à Erevan pour le match de football Turquie-Arménie du 6 septembre. Le 24 juillet, quelques jours avant la guerre d’Ossétie, était inaugurée la liaison ferroviaire turco-géorgo-azerbaïdjanaise. Puissance économique régionale, la Turquie est donc devenue un acteur politique important dans toute la région de l’Ukraine à l’Iran.
C’est aussi le cas au Proche et au Moyen-Orient, depuis que le gouvernement turc a refusé de suivre Bush en Irak. Et l’on a vu la diplomatie turque permettre le contact entre Israël et la Syrie, prendre langue avec le Hamas, conserver un lien avec Téhéran malgré la rivalité des deux pays (le 15 août 2008, le président iranien était à Ankara). Toutefois l’agression israélienne à Gaza a sérieusement détérioré les relations israélo-turques et, comme le remarque le journaliste turc Cengiz Çandar, l’État hébreu est tenté de faire peser une « hypothèque israélienne » contre une politique régionale turque trop distante d’Israël, en menaçant de faire pression aux États-Unis pour la reconnaissance du génocide arménien et de perturber le rapprochement en cours avec l’Arménie ou en critiquant la politique kurde d’Erdogan, voire en soutenant discrètement les nationalistes kurdes du PKK [1]
Un règlement de la question chypriote proche de la solution préconisée par l’ONU en 2004 (à l’époque rejetée par les Chypriotes grecs), et qui avait été soutenu par Erdogan, pourrait servir de modèle pour le Caucase. L’arrivée au pouvoir à Nicosie des progressistes de l’AKEL [2] rend cette perspective possible, sauf si la pression de l’armée turque et de l’opposition kémaliste en Turquie parvient à bloquer ce processus.
De plus, si ce positionnement médiateur et indépendant de la Turquie était mal vu de l’équipe Bush, il est à l’évidence compatible avec le nouveau positionnement de l’administration Obama. Celui ci s’est d’ailleurs très significativement rendu en Turquie lors de sa tournée européenne d’avril 2009 après le G20 de Londres et le sommet de l’OTAN à Strasbourg. Enfin, renforçant la place régionale de la Turquie, il la met politiquement en bien meilleure posture pour négocier avec l’Union européenne. La Turquie devient un acteur indispensable pour le développement de la politique de voisinage de l’Union, et démontre en même temps qu’elle n’est pas l’obligée des Européens. Même ce turcophobe de Sarkozy a dû s’adapter à ce nouveau poids politique régional de la Turquie.
La Turquie n’est plus en posture de conquérant agressif, et elle sort de ce complexe de dernier morceau d’empire qui la taraudait malgré la révolution kémaliste. Elle ne rêve plus de constituer un empire touranien des populations turcophones comme en 1914, elle n’est plus en état d’avant-guerre permanent contre le rival russe comme elle l’a été pendant trois siècles, et jusqu’en 1989. Le positionnement turc actuel est d’une certaine manière triple. L’option européenne demeure prioritaire, surtout pour la bourgeoisie moyenne entrepreneuriale (qui constitue une des bases sociales et électorale du parti islamiste au pouvoir AKP) et pour les intellectuels, les courants démocrates, les associations et mouvements de la société civile ; cette option annoncée par l’adhésion de la Turquie au Conseil de l’Europe en 1948, esquissée depuis l’accord de partenariat privilégié conclu en 1963 avec ce qui était encore la Communauté économique européenne, est clairement ouverte depuis l’accord de libre-échange de 1996 et les négociations d’adhésion entamées ensuite. Pour les Turcs, cette priorité ne signifie pas la fermeture vis-à-vis de l’Est, l’espace économique commun possible avec l’Asie centrale mais aussi la Russie, l’Ukraine, etc., et qui fonctionne déjà largement si on en juge par l’activité du grand bazar d’Istanbul, ni l’abandon d’une posture d’avant-garde « modérée » des pays musulmans, un « nouvel ottomanisme », comme le présentait l’édition turque de Newsweek en février 2009 [3], ce qui ne déplairait pas aux Américains. Si l’Europe laissait la Turquie à ses marges, nul doute que les deux autres options prendraient une autre forme parce que développées sans les autres Européens. Voire contre eux ?


